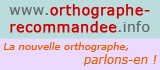|

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Trouver la bonne traduction ou le bon terme sur le site du
Ministère de la Culture et de la Communication.

Les questions courantes sur la langue française sur le site de
l'Académie française.
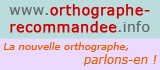
Ce site donne différentes informations sur la nouvelle orthographe
française parue au Journal officiel de la République française et
approuvée par l'Académie française ainsi que par les instances
francophones compétentes.
|
Ma collection de mots
Mots qui n'existent que dans une expression
Voici une liste de mots à usage unique, c'est à dire que l'on
ne trouve quand dans une expression ou une locution.
| Mot |
Expression / mot composé |
Définition du mot seul |
Sens de l'expression |
| achoppement |
pierre
d'achoppement |
Action de trébucher, heurter en marchant. |
Obstacle, difficulté qui peut faire échouer une
entreprise. |
| aînesse |
le droit
d'aînesse |
Priorité d'âge entre frères et sœurs. |
Privilège attaché à la priorité d'âge entre frères
et sœurs. |
| api |
pomme d'api |
Francisation du nom de Claudius Appius, qui
aurait apporté cette variété de pommes du Péloponnèse (en latin mala
appiana, « pomme d'Appius » ). |
Variété de petites pommes fermes et d'un beau
rouge vif. |
| bée |
Bouche bée |
Participe passé de l'ancien français baer,
beer, « bayer ». |
Bouche ouverte d'admiration, d'ébahissement. Fig.
Être bouche bée devant quelqu'un, lui témoigner une vive
admiration, mêlée d'étonnement. |
| berlue |
avoir/donner la
berlue |
Sorte d'éblouissement, ordinairement passager, qui
empêche de voir les choses telles qu'elles sont. |
|
| bonnement |
tout bonnement |
De bonne foi, naïvement, avec simplicité. |
|
| bric |
de bric et de
broc |
|
De-ci, de-là, D'une manière ou d'une autre. Le mot
broc est le nom masculin qui désigne le récipent. |
| çà (avec un accent) |
çà et là, ha çà ! |
Il s'employait souvent autrefois pour signifier
Ici, vers cet endroit-ci. |
Ça et là : de côté et d'autre. Ha çà : marque
l'étonnement. |
| chaloir |
peut me chaut (*) |
Ancien verbe. Empr. au lat. calere « être
chaud » au sens propre. « s'inquiéter » |
Il ne m'importe. |
| chape |
chape de plomb |
Ce qui recouvre, enveloppe, protège. |
Au sens figuré : ce qui pèse, écrase, paralyse. |
| châtain |
des cheveux
châtains |
Qui est couleur de châtaigne, d'un brun-roux plus
ou moins foncé. |
|
| clin |
clin d'œil |
Déverbal du verbe cligner. |
Mouvement rapide de la paupière qu'on abaisse et
qu'on relève instantanément. |
| cliques |
Prendre ses
cliques et ses claques |
Dérivé d'une onomatopée imitant un bruit sec.
Anciennt. Nom donné aux sabots de bois dans certaines provinces
(on disait aussi Claques). |
S'en aller brusquement en emportant, ou non, ses
affaires. |
| coudée |
avoir les coudées
franches |
Espace nécessaire pour que les coudes jouent
librement. |
Disposer d'une entière liberté d'action, n'être
contraint par rien ni par personne |
| dam |
à mon (grand) dam
|
Dommage, préjudice. |
|
| étancher |
étancher la soif
|
Faire cesser. |
Apaiser la soif, se désaltérer. |
| escampette |
Prendre la poudre
d'escampette. |
Diminutif d'escampe, « fuite », déverbal
d'escamper. S'escamper : S'esquiver, se retirer
furtivement. |
Prendre la fuite sans se faire remarquer,
déguerpir. |
| escient |
à bon escicent |
Pleine connaissance d'une chose. |
En connaissance de cause, sciemment. |
| férir |
sans coup férir |
Frapper. |
Sans frapper un seul coup, sans tirer l'épée, sans
éprouver de résistance. |
| for |
for intérieur |
Dans son for intérieur. |
La conscience intime où se forme un jugement, même inexprimé. |
| fur |
au fur et à
mesure |
Vieux mot qui signifiait Taux, Proportion. |
Selon une certaine proportion et une certaine
succession dans le temps. |
| go
|
tout de go |
|
Sans préambule, directement. Sans cérémonie, sans
façon. |
| guilledou |
courrir le
guilledou (*) |
Probablement composé à partir du radical de
l'ancien français guiller, « tromper, séduire », et de
l'adjectif doux au sens de « tendre, agréable ». |
Chercher des aventures galantes et faciles. |
| guise |
à ma (ta, sa...)
guise / en guise de |
Manière, façon. |
Comme il plaît, comme on l'entend. / En manière
de, pour tenir lieu de. |
| haro |
crier haro sur le
bodet |
Dérivé de l'ancien français hare, cri
par lequel on marquait la fin d'une foire, puis cri poussé pour
exciter les chiens, issu du francique *hara, « ici, de
ce côté ». |
Se récrier avec indignation sur ce qu'il fait ou
dit mal à propos, le désigner à la réprobation de tous. |
| leu |
à la queue leu leu |
Ancienne forme du mot Loup. |
À la suite les uns des autres. |
| lurette |
belle lurette |
Altération d' heurette, diminutif d' heure.
Terme familier utilisé pour désigner le temps passé. |
Il y a bien longtemps. |
| martel |
se mettre/avoir
martel en tête (*) |
Emprunté de l'italien martello, «
marteau », puis « jalousie ; souci ». Forme ancienne de Marteau. |
Éprouver une vive inquiétude, être préoccupé à
l'excès par un souci, un objet particulier. |
| opimes |
dépouilles opimes
(*) |
« riche » |
Dépouilles que remportait un général victorieux
qui avait tué de sa main le chef de l'armée ennemie. |
| prou |
peu ou prou |
Assez, beaucoup. |
Plus ou moins. |
| rez |
rez-de-chaussée |
Tout contre; à, au ras de; au niveau de. |
Partie d'une maison qui est, ou à peu près, au
niveau du terrain. |
| tournemain |
En un tournemain |
Action de tourner la main. |
En aussi peu de temps qu'il en faut pour tourner
la main. |
| soussigné |
Je soussigné, nous
soussignés,... |
Dont la signature est ci-dessous. |
|
| vau |
à vau-l'eau |
|
Au figuré : au gré du hasard, à l'abandon, à la
dérive. |
| vergogne |
sans vergogne |
Honte. |
Qui n'a pas honte. |
Mots qui n'existent que dans une expression très peu connue
| Mot |
Expression / mot composé |
Définition du mot seul |
Sens de l'expression |
| ad hominem |
argument ad
hominem |
Locution latine formée de ad, « vers, contre », et
hominem, accusatif de homo, -inis, « homme ». |
Argument qui vise personnellement un adversaire,
qui doit sa valeur particulière aux actes, aux déclarations de la
personne visée. |
| birbe |
vieux birbe |
Du provençal birbo, « canaille », ou de l'italien
birba, « vaurien » |
Vieillard rétrograde. |
| chauvir |
chauvir des
oreilles |
Probablement dérivé d'une désignation de la
chouette, qui dresse ses oreilles de la même façon. |
Dresser les oreilles, en parlant des chevaux, des
ânes et des mulets. |
| coucheur |
un mauvais
coucheur |
Dérivé de coucher. Vieilli. Personne qui partage
le lit d'une autre. |
Personne d'humeur difficile, querelleuse,
chicanière. |
| coulpe |
battre sa coulpe |
Du latin classique culpa, « faute ». |
Se frapper la poitrine, en répétant « Mea culpa !
» ou « C'est ma faute ! ». Par ext. S'accuser d'une faute,
manifester son repentir. J'ai commis une lourde erreur et je
bats ma coulpe. |
| margoulette |
se casser la
margoulette |
Fam. Mâchoire et, par méton., visage. |
Tomber. |
| prétentaine |
courir la
prétentaine |
Origine incertaine. |
Être toujours par voies et par chemins, aller
de-ci, de-là. Ne s'emploie plus que figurément. |
| quellement |
tellement
quellement |
|
Ni bien ni mal et plutôt mal que bien. Il
fait son devoir, il s'acquitte de ses fonctions tellement
quellement. Je me porte tellement quellement. |
Mots qui n'existent que dans une expression mais tirés d'un nom propre
| Mot |
Expression / mot composé |
Définition du mot seul |
Sens de l'expression |
| gordien |
Trancher le nœud
gordien |
Dérivé du latin Gordius, lui-même emprunté du grec
Gordios, nom d'un roi légendaire de Phrygie. |
résoudre brutalement une difficulté qui semblait
insoluble (par allusion au nœud fixant l'attelage du char de
Gordios, qu'Alexandre trancha d'un coup d'épée au lieu de le
dénouer) |
| colin-tampon |
Je m'en moque
comme de colin-tampon |
Au sens premier « batterie de tambour des Suisses
». Composé du nom propre Colin et de tampon, employé par
plaisanterie pour tambour. Chose insignifiante. |
Je n'en fais aucun cas, je ne m'en soucie
nullement. |
Mots qui n'existent que dans une expression mais tirés d'un mot existant
| Mot |
Expression / mot composé |
Définition du mot seul |
Sens de l'expression |
| appellatif |
nom appellatif |
(en tant qu'adjectif) Emprunté du latin
appellativus, qui traduit le grec prosêgorikos, « dont on sert
pour nommer ». |
Terme qui convient à une espèce entière, par
opposition à nom propre. Homme, arbre sont des noms
appellatifs. (On dit plutôt Nom commun.) |
| boire |
le boire et le
manger |
(en tant que nom masculin) Emploi substantivé du
verbe boire. Le fait de boire. |
Les nécessités de la vie. |
| cessant |
toute chose
cessante, toute affaire cessante |
(en tant qu'adjectif) Participe présent de cesser. |
Qui cesse. |
| cesse |
n'avoir de cesse,
sans cesse |
(en tant que nom féminin) Déverbal de cesser. |
Le fait de cesser. |
| coule |
à la coule |
(en tant que nom féminin) Déverbal de couler.
Remarque : différent du vêtement à capuchon et à larges manches
propre aux membres de certains ordres monastiques. |
Faire passer sans difficulté. |
| culminant |
le point
culminant |
(en tant qu'adjectif) Participe présent de culminer. |
Le point le plus haut. [figuré] Être à son plus
haut degré ; être à son apogée. |
| débarqué |
un nouveau
débarqué, une nouvelle débarquée |
(en tant que nom) Participe passé substantivé de
débarquer. |
Personne récemment arrivée de sa province et, fig.
et péj., personne naïve et sans contenance. |
| mâche |
avoir de la mâche |
(en tant que nom féminin) Déverbal de mâcher.
Remarque : le sens est différent de la plante herbacée. |
Qui se dit d'un vin riche en tanin, et d'une
saveur consistante. |
|
 Home Page
Home Page  My Softwares
My Softwares  Painting gallery
Painting gallery  Video tries
Video tries Board Games
Board Games  The French Language (in french)
The French Language (in french)
 The Itoura Moussongo's Page (in french)
The Itoura Moussongo's Page (in french)  Links (in french)
Links (in french)

 Français
Français

 English
English